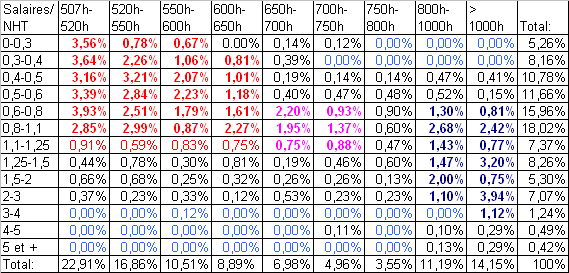
Dans les écrits des sociologues et économiques qui s’occupent des transformations du capitalisme et plus spécifiquement des transformations du marché du travail artistique et culturel, il y a une tendance à faire de l’activité artistique et de ces modalités d’exercice le modèle auquel s’inspirerait l’économie néo-libérale. Ce discours est ambigu et mérite d’être interrogé. Le Nouvel Esprit du Capitalisme a le mérite de faire de la « critique artiste » un des acteurs économiques, politiques et sociaux du siècle qui vient de s’écouler et notamment de l’après deuxième guerre mondiale. Mais aussi bien la définition de qu’est-ce que c’est la « critique artiste », que le rôle que les auteurs lui font jouer dans le capitalisme contemporain, nous laissent perplexes à plusieurs égards.
La thèse qui court tout au long du « Le nouvel esprit du capitalisme » est la suivante : la critique artiste (fondée sur, et revendiquant la liberté, l’autonomie et l’authenticité) et la critique sociale (fondée sur, et revendiquant la solidarité, la sécurité et l’égalité) « sont le plus souvent portées par des groupes distincts » et sont « incompatibles ».[1] Le flambeau de la critique artiste, transmis par les artistes aux étudiants de mai 68, aurait été repris par la suite par les gens « branchés » qui travaillent dans les médias, la finance, le show business, la mode, Internet, etc., c’est-à-dire, les « créatifs » du « haut de la hiérarchie socioculturelle ». La critique sociale, par contre, portée par les ouvriers de 68, aurait été reprise par les petits gens, les subordonnés, les exclus du libéralisme. Critique artiste et critique sociale sont donc « largement incompatibles ».
La « critique artiste » suscite un malaise chez les auteurs, voir un certain mépris, qu’ils ont du mal à cacher. De leur point de vue, cela se comprend aisément, puisque la « critique artiste […] n’est pas spontanément égalitaire ; elle court même toujours le risque d’être réinterprétée dans un sens aristocratique » et « non tempérée par les considérations d’égalité et de solidarité de la critique sociale peut très rapidement faire le jeu d’un libéralisme particulièrement destructeur comme nous l’ont montré les dernières années ». D’ailleurs, la critique artiste n’est « pas en soi nécessaire à la mise en cause efficace du capitalisme comme le montrent les succès antérieurs du mouvement ouvrier sans les renforts de la critique artiste. Mai 68 était, de ce point de vue, exceptionnel ». A la lecture, on sent aussi que le livre est parcouru par un ressentiment contre mai 68 qui, depuis quelques années, traverse les élites intellectuelles françaises, et dont font les frais, ici aussi, comme chez l’ancien ministre de l’Education Nationale, Michel Foucault, Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui, en tant que maîtres de la pensée 68, auraient déposés des germes de libéralisme dans les têtes de gens sans y prendre garde.
Donc non seulement la critique artiste n’est pas nécessaire, sinon à « modérer le trop d’égalité de la critique sociale » qui risque de « faire fi à la liberté » (sic), mais en plus elle joue le cheval de Troie du libéralisme, à qui elle est apparenté par le goût aristocratique de la liberté, de l’autonomie et de l’authenticité que les artistes auraient transmis d’abord aux « étudiants », et qui aurait ensuite transité chez les « bobos ». Boltanski et Chiapello nous rejouent ici l’opposition de la liberté et de l’égalité , de l’autonomie et de la sécurité, d’une autre époque, sur laquelle d’ailleurs se sont cassés les dents aussi bien le socialisme et le communisme,.
« Pas de culture sans droits sociaux »
Le concept de «critique artiste » ne tient pas la route, pour des questions à la fois théoriques et politiques :
a) Pour ce qui concerne ce dernier aspect, les thèses de B&C ont subi un démenti cinglant quatre ans après leur publication. Les malheurs de la « critique artiste » de Boltanski et Chiappello sont nombreux, mais le plus grand lui est arrivé avec la naissance de la « Coordination des Intermittents et Précaires » et du mouvement de résistance des « artistes » et des « techniciens » du spectacle dont elle constitue l’expression la plus aboutie. Les six mots d’un des slogans du mouvement des intermittents « Pas de culture sans droits sociaux » suffisent, abondamment, pour en faire la critique du livre de Boltanski et Chiappello et pour faire ressortir toutes les limites de leur analyse du capitalisme contemporain. Si l’on traduit le slogan « Pas de culture,sans droits sociaux » dans le langage de B. et C., on aura que ce qui est considéré comme potentiellement aristo-libérale, comme incompatible avec la justice sociale, devient un terrain de lutte, le seul, peut-être, à partir duquel on peut faire échec à la logique néo-libérale : « pas de liberté, d’autonomie, d’authenticité (culture), sans solidarité, égalité, sécurité (droits sociaux) ».
Le nouvel esprit du Capitalisme a été publié en 1999, mais il a cessé de fonctionner théoriquement et politiquement dans la nuit du 25 au 26 juin 2004 lorsque au Théâtre Nationale de la Colline a été fondée la « Coordination des intermittents et précaires ».
La « critique artiste », lorsque, portée par des « artistes et techniciens du spectacle », elle s’est organisée et qu’elle s’est nommée, a mis ensemble ce que les auteurs considèrent incompatibles : l’artiste et l’intérimaire, l’artiste et le précaire, l’artiste et le chômeur, l’artiste et l’Rmiste.
La résistance la plus forte et la plus acharnée (le conflit dure depuis trois ans) au projet libéral de patronat français, la « refondation sociale », vient des artistes et des techniciens du spectacle. Ce sont les « Coordinations des intermittents et précaires » qui ont élaboré et proposé un modèle d’indemnisation des « travailleurs à l’emploi discontinu », et pas seulement des artistes et techniciens du spectacle, fondée sur la solidarité, la sécurité et la justice. Ce sont toujours les coordinations qui ont indiqué les terrains de lutte pour un système d’assurance-chômage fondée à la fois sur la sécurité et sur l’autonomie, capable de fonctionner à même la mobilité.
b) Du point de vue théorique, le concept de « critique artiste » introduit une foule des malentendus. Nous prenons en considération que les trois majeurs :
1. Les clivages que les politiques libérales ont creusés dans la société n’ont rien à voir avec la caricature de la composition sociale et la cartographie des inégalités, décrite dans ce livre.
Reprenons la description des groupes sociaux porteurs, selon B&C, de la « critique artiste » et essayons de voir pourquoi elle est caricaturale (à la limite du populisme) :
« Par ailleurs, il faut bien voir que la critique artiste est aujourd’hui surtout portée par des personnes placées en haut de la hiérarchie socioculturelle, qui ont fait des études supérieures, qui travaillent souvent dans des secteurs créatifs (le marketing, la pub, les médias, la mode, internet, etc.) ou encore sur les marchés financiers ou dans des sociétés de conseil, et que leur sensibilisation à ce qu’est, à l’autre bout de l’échelle sociale, la vie d’un ouvrier intérimaire, qui n’a, lui, aucune espèce d’intérêt à la mobilité, est pas loin d’être nulle. »
Les clivages que les politiques néo-libérales tracent ne sont pas entre les nouvelles professions libérales et les nouveaux prolos, entre les branchés et les chômeurs, entre une nouvelle « classe créative », qui travaille dans les « industries créatives », et une vieille classe ouvrière qui travaille dans les industries traditionnelles, mais les inégalités sont internes aux soi-disant métiers créatifs, que selon B. et C. porte la « critique artiste ». Chacune de professions qu’ils citent comme les porteurs de la critique artiste n’est pas une entité homogène, mais un ensemble de situations fortement différenciés à l’intérieur, par les statuts, les salaires, la couverture sociale, la charge de travail, l’emploi. Vous pouvez travailler dans la même profession, être riche et garanti ou pauvre et dans une situation d’extrême précarité. Entre ces deux extrêmes, vous avez une gradation et une modulation presque infinie des situations et des statuts.
Les clivages ne sont pas entre des individus qui travaillent dans les médias, la publicité, le théâtre, la photographie, d’une part, et les ouvriers, les employés, les précaires et les chômeurs, d’autres part. Les clivages traversent les nouvelles professions libérales, puisque, tout simplement, une partie des individus qui y travaillent sont précaires, pauvres, non garanti.
On pourrait dire exactement la même chose de presque toutes les professions que les auteurs citent, et notamment des chercheurs et de l’université que les auteurs devraient connaître mieux. Situation que le mouvement des « chercheurs précaires » a contribué à dénoncer quelque mois après le mouvement des intermittents.
Prenons un exemple où il y a des données : celui des artistes et techniciens (intermittents) de l’audio-visuel et du spectacle vivant, où nous avons menés, avec Antonella Corsani et Jean Baptiste Olivo et les Coordinations des Intermittents et précaires , une enquête sur un échantillon représentatif de plus de 1000 intermittents, et regardons les distributions internes de l’emploi (les heures travaillé) et des salaires (sans les allocations chômage) :
Tableau 1 : Structure par tranche de NHT et tranche
de salaire annuel (en SMIC)
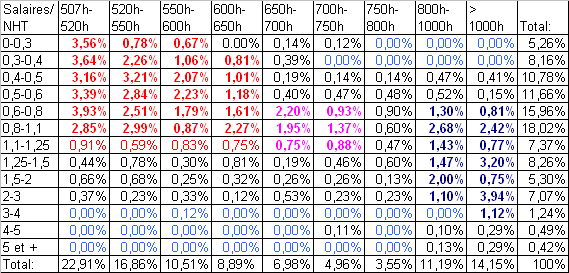
Il apparaît très clairement que le plus grand nombre d’intermittents (56.4%) gagnent un salaire annuel compris entre la moitié d’un SMIC (le SMIC est d’environ 1200 euros brut) et un peu plus d’un SMIC. Cependant, aux deux extrêmes, 9.1% gagne un salaire équivalent à plus de 2 SMIC, 13.5% gagne un salaire qui n’atteint pas 0.3 SMIC.
Tableau 2 : Salaire moyen, médian et écart-type en
fonction du métier
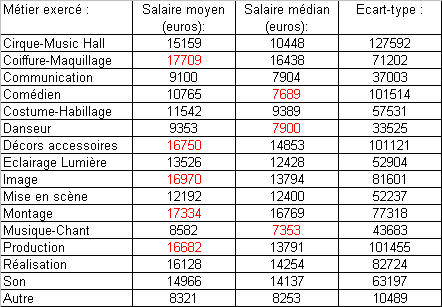
La majorité des intermittents vivent donc à peine au-dessus de seuil d’indemnisation (507 heures), mais il y a une quantité non définie d’ « artistes » non indemnisés qui vivent dans une situation de encore plus grande précarités, en jonglant entre emplois précaires, RMI et minima sociaux. Je rappelle qu’à Paris, 20 % des Rmistes déclarent comme activité « artiste ».
Si l’on ajoute ce qu’on appelle les plasticiens, les « artistes » sont une catégorie très différenciée, que l’on ne peut pas saisir avec les catégories « molaire » et englobantes d’artistes, des individus que travaillent dans les médias, etc.
2. B. et C. ont fait de l’artiste et de son activité, le modèle de l’économie libérale, alors que ce modèle a été construit sur le « capital humain » en tant qu’entrepreneur de soi-même.
Nous allons utiliser le travail de Foucault, « Naissance de la bio politique » pour rendre compte du malentendu selon lequel le modèle de l’activité économique contemporaine il faudrait le chercher chez les artistes:
Comme le rappelle Foucault, le néo-libéralisme a besoin de reconstruire un modèle d’homo œconomicus, mais, comme nous allons voir tout de suite, il n’a pas grand chose à voir ni avec l’artiste, ni avec la « créativité » artistique. Le néo-libéralisme ne cherche pas son modèle de subjectivation dans la critique artiste puisqu’il a le sien : l’entrepreneur, qui s’ailleurs il veut généraliser à tout le mode, artiste compris, comme dans le cas des intermittents français. Dans la « réforme » de l’intermittence, la nouvelle période d’indemnisation des intermittents est considérée « un capital » des jours indemnisés que l’individu doit gérer en tant que « capital ».
Qu’est-ce qu’il fait ce petit mot de « capital » chez des salariés ? Comment opère-t-il ?
Il énonce que les allocations chômage font partie de la multiplicité d’ « investissements » (en formation, mobilité, affectivité, etc.) que l’individu (le « capital humain ») doit effectuer pour optimiser ses performances. L’analyse de Foucault peut nous aider à voir ce que vise « positivement » la logique néo-libérale, ce à quoi elle incite à travers son modèle de « capital humain ». La capitalisation est une des techniques qui doit contribuer à transformer le travailleur en « capital humain » qui doit assurer lui-même la formation, la croissance, l'accumulation, l'amélioration et la valorisation de « soi » en tant que « capital », à travers la gestion de toutes ses relations, ses choix, ses conduites selon la logique du rapport coûts / investissement et d’après la loi de l’offre et de la demande. La capitalisation doit contribuer à faire de lui « une sorte d’entreprise permanente et multiple. Le travailleur est un entrepreneur et un entrepreneur de lui-même, « étant à lui-même son propre capital, étant pour lui-même son propre producteur, étant pour lui-même la source de ses revenus. »[2] Ce qui est demandé aux individus n’est pas d’assurer la productivité du travail, mais la rentabilité d’un capital (de leur propre capital, d’un capital inséparable de leur propre personne). L’individu doit se considérer lui-même comme un fragment de capital, une fraction moléculaire du capital. Le travailleur n’est plus un simple facteur de production, l’individu n’est pas, à proprement parler, une « force de travail », mais un « capital-compétence », une « machine-compétences ».
Cette conception de l’individu comme entrepreneur de soi-même est l’aboutissement du capital comme machine de subjectivation. Pour Gilles Deleuze et Félix Guattari, le capital agit comme un formidable « point de subjectivation constituant tous les hommes en sujet, mais les uns, les capitalistes, sont des sujets d’énonciation, tandis que les autres, les prolétaires, sont des sujets d’énoncé assujettis aux machines techniques »[3]. On peut parler d’accomplissement du processus de subjectivation et de l’exploitation, puisque ici c’est le même individu qui se dédouble, à la fois sujet d’énonciation et sujet d’énoncé. D’une part, il porte la subjectivation au paroxysme, puisqu’il implique toutes les ressources « immatérielles » et « cognitives » de son « soi » dans l’activité et d’autre part, il porte à identification, subjectivation et exploitation, puisqu’il est à la fois patron de lui-même et esclave de lui-même, capitaliste et prolétaire, sujet d’énonciation et sujet d’énoncé.
Toujours à partir de Foucault, on peut fortement critiquer la thèse selon laquelle ce sont 68 et les étudiants qui ont introduit la liberté dans le capitalisme. Selon Foucault, le libéralisme est un mode de gouvernement qui consomme de la liberté, et pour pouvoir la consommer il faut d’abord la produire et la favoriser. La liberté n’est pas une valeur universelle dont le gouvernement devrait garantir l’exercice, mais la liberté (les libertés) dont le libéralisme a besoin pour fonctionner. La liberté est tout simplement « le corrélatif des dispositifs de sécurité » que Foucault décrit dans Naissance de la Biopolitique. La grande différence avec le libéralisme keynésien est que la liberté qu’on doit fabriquer et organiser est, d’abord, celle de l’entreprise et de l’entrepreneur, tandis que la liberté du « travail », du « consommateur », de la politique, qui étaient au centre de l’intervention keynésienne, leur doivent être radicalement subordonnées. Il s’agit toujours de la liberté des entrepreneurs.
3. Le problème : la conception de la « critique artiste » nous renvoie à une conception de l’activité artistique révolue et qui peut-être, dans les termes décrites par B&C, n’a jamais existé.
« Mais on sait bien que, alliée, depuis le 18ème siècle et surtout au 19ème siècle, aux conceptions de l’art comme ‘sublime’ et de l’artiste comme ‘génie’, la critique artiste s’est souvent accompagnée d’un mépris pour le ‘commun’, pour les ‘petits bourgeois’, pour les ‘beaufs’, etc. Certes, le ‘peuple’ ou le ‘prolétariat’ pouvaient paraître à l’abri de ce mépris, mais parce que la critique s’en donnait un tableau idéalisé et purement abstrait. Le ‘peuple’, comme entité, était conçu comme ‘admirable’, mais ses représentants réels, quand par aventure il arrivait aux tenants de la critique artiste de les croiser, ne pouvaient sembler que décevants, avec des préoccupations ‘terre à terre’, ‘rétrogrades’, etc. »
Cette image de l’artiste correspond parfaitement à celle que le Ministre de la Culture fait imposer aux intermittents à travers les politiques de l’emploi culturel. Ce sont les libéraux qui siègent au Ministère de la Culture français qui ont aujourd’hui cette image de l’artiste.
4. « La mobilité des petits étant le plus souvent une mobilité subie, n’est pas vraiment de nature à créer du réseau. Ils sont ballottés au gré de leurs fins de contrats et courent d’un employeur à l’autre pour ne pas disparaître définitivement de la toile. Ils circulent comme marchandises dans un réseau dont ils ne tricotent jamais la maille, et sont échangés par d’autres qui s’en servent en revanche pour entretenir leurs propres connexions. Comme nous l’expliquons lorsque nous évoquons la nature de l’exploitation en réseau, la mobilité du grand, source d’épanouissement et de profit, est exactement à l’opposé de celle du petit qui n’est qu’appauvrissement et précarité. Ou, pour reprendre l’une de nos formules, la mobilité de l’exploiteur a pour contrepartie la flexibilité de l’exploité. »
Ce sont les plus pauvres, les plus « petits » qui ont porté le mouvement des intermittents. Ce sont les « petits »qui se sont montrés beaucoup plus « créatifs », plus « mobiles », plus « dynamiques », que les syndicats des salariés porteurs de la critique sociale. Les coordinations ne sont pas fréquentées seulement par des intermittents, mais aussi par des précaires, des chômeurs, des Rmistes, et c’est cet ensemble des « petits » qui a inventé et géré un des conflits les plus novateurs des dernières années.
La preuve que la théorie de B. & C. est très limitée vient du fait que le libéralisme n’a pas généralisé les modalités de travail des intermittents, les seuls artistes avec un statut de salariés, mais il leur a imposé les contraintes économiques de l’entrepreneur de soi-même, du modèle du capital humain. C’est bien l’artiste et le technicien du spectacle qui doit assumer les comportements et les styles de vie du « capital humain ».
Menger et les malheurs de l’emploi culturel permanent
Pierre-Michel Menger fixe, à travers sa préconisation d’une politique de l’emploi culturel permanent, les limites de l’action possible et raisonnable dans le marché du travail culturel : la « régulation » du « trop » d’artistes et des techniciens intermittents. Le travail de Menger montre bien la complicité, l’imbrication, la complémentarité et la convergence de la « droite » et de la « gauche » autour de la bataille pour l’emploi. Son dernier livre est tout construit sur l’opposition « disciplinaire » entre normal et anormal, comme son titre l’indique clairement : Les intermittents du spectacle : sociologie d’une exception.[4] Pour Menger, « il ne s’agit pas d’un chômage ordinaire, tout comme il ne s’agit pas d’un emploi ordinaire […] La réglementation du chômage des intermittents est celle d’une couverture atypique d’un risque atypique. Mais la flexibilité hors normes a des conséquences redoutables. »[5]
Chômage et emploi extra-ordinaires, risque et couverture des risques atypiques, flexibilité « hors normes », nous sommes en pleine « exception » disciplinaire. Menger enveloppe ses argumentations sur le secteur de la culture et du régime de l’intermittence dans une formalisation savante qui vise à renfermer les questions posées par le mouvement des intermittents dans le cadre rassurant de l’anormal, de l’exception, de l’atypique.[6] Les politiques de l’emploi à mettre en œuvre doivent éradiquer l’exceptionnel et rétablir le fonctionnement standard du marché du travail qui prévoit à la fois la reconstruction de la fonction d’entrepreneur (son autonomie) et la réimposition de la fonction du salarié (sa subordination), de façon de pouvoir assigner les droits et les devoirs de chacun.
Pour le dire dans les termes durkheimien du savant, il faut rétablir une « hiérarchie directe et organisée » sur un marché du travail déréglé par de conduites non conformes à la normalité de la relation capital/travail. Nous savons que ces fonctions ne mènent pas une existence naturelle, mais qu’il faut les produire et les reproduire par une intervention continue des politiques de l’emploi. Ce que la reforme s’est employé à faire.
Si l’analyse de
l’intermittence par Menger semble se situer à l’opposé de celle des
néo-libéraux, ses conclusions recouvrent parfaitement celles de ces derniers.
Etant donné que le nombre d’individus qui entrent dans le régime d’emploi
intermittent augmente beaucoup plus rapidement que le volume de travail qu’ils
se partagent[7], le marche
de l’emploi culturel est caractérisé par une hyperfléxibilité qui détermine une
concurrence accrue entre les intermittents. L’augmentation de la concurrence
entre travailleurs a des conséquences néfastes sur leurs conditions d’emploi
(des contrats de plus en plus courts et fragmentés), sur leurs rémunérations
(des salaires à la baisse) et sur le pouvoir de négociation avec les
entreprises.
Le « constat », il y a trop d’intermittents pour pouvoir garantir à
tous des bonnes conditions d’emploi et d’indemnisation, impose la même solution
que la reforme : il faut en réduire le nombre, en rendant plus difficile
l’accès au régime d’assurance chômage, mais aussi en sélectionnant les
candidats aux métiers du spectacle en établissant des barrières à l’entrée
(diplômes, formation contrôlée par l’Etat). La lutte contre
l’hyperflexibilité, contre le sous-emploi et contre les bas salaires des
intermittents et la lutte pour assurer un emploi stable et continue, des
« bonnes » rémunérations et des « bonnes » indemnisations à
un nombre réduit d’intermittents, a comme première conséquence celle de
renvoyer le « trop » d’intermittents au RMI, aux minima sociaux, aux
stages, à la précarité, à la survie, à la pauvreté.
Les premières données sur les effets de la reforme montrent le triomphe de la politique néo-libérale et la complète subordination des politiques de l’emploi culturel.[8] Il se rejoue ici ce qui se passe dans les autres domaines de l’économie depuis 30 ans : la politique de l’emploi culturel (créer de « vrais » emplois, stables et à plein-temps), en négligeant les conditions actuelles de la production, divise, fragmente le marché du travail en créant une disparité croissante de situations. Elle ne fait qu’alimenter la différentiation, démultiplier les inégalités et constituer ainsi le terreau idéal pour que la gestion néo-libérale du marché du travail puisse s’implanter et se déployer. Les politiques de l’emploi (culturel) sont subordonnées à la logique libérale, parce qu’en voulant réduire la concurrence dans la « corporation », elles ne font que segmenter, différencier ultérieurement, accroître la concurrence entre « garantis » et « non garantis », entre emplois stables et emplois précaire et rendre ainsi possible la politique de l’« optimisation des différences », la gestion différentielle des inégalités du gouvernement des conduites sur le marché du travail.
Le chômage et le travail invisible
L’analyse du chômage aboutit à la même distinction disciplinaire entre normal (l’assurance-chômage telle qu’elle a été instituée dans l’après-guerre) et anormal (l’assurance-chômage telle qu’elle a été utilisée, détournée, approprié par les intermittents). Menger, comme tous les experts des politiques de l’emploi culturel, voudrait ramener l’assurance-chômage pervertie par l’intermittence (puisqu’elle finance aussi l’activité, les projets culturels, artistiques et les projets de vie des intermittents) à sa fonction dite « naturelle » de simple couverture de risque de perte d’emploi. Mais Menger, comme les experts, semblent ignorer que dans un régime d’accumulation flexible, le chômage change de sens et de fonction. La séparation nette et tranchée entre emploi et chômage (le chômage comme envers de l’emploi), institué dans un régime d’accumulation fort différent (standardisation et continuité de la production et donc stabilité et continuité de l’emploi), s’est transformé en une imbrication de plus en plus étroite entre périodes d’emploi, périodes de chômage et périodes de formation.
La première chose qui saute littéralement aux yeux, lorsque vous analysez le secteur culturel, est la disjonction entre travail et emploi. La durée de ce dernier ne décrit que partiellement le travail réel qui l’excède. Les pratiques de « travail » des intermittents (formation, apprentissage, circulation de savoirs et des compétences, modalité de coopération etc.) passent par l’emploi et le chômage, sans s’y réduire.[9] À partir du début des années 70, le temps de l’emploi ne recouvre que partiellement les pratiques de travail, de formation, de coopération des intermittents et le chômage ne se réduit pas à être un temps sans activité. L’assurance-chômage ne se limite pas à couvrir le risque de perte d’emploi, mais garantie la continuité de revenus qui permettent de produire et de reproduire l’imbrication de toutes ces pratiques et ces temporalités, et qui ici ne sont pas à la charge complète du salarié comme dans d’autres secteurs.
Employeur/salarié
Les énoncés – mots d’ordre de l’emploi – empêchent Menger de saisir le sens d’une autre mutation qui bouleverse non seulement la séparation tranchée entre travail et chômage, mais aussi les fonctions que le « Code du travail » attribue aux salariés (la subordination) et celles qu’il attribue aux entrepreneurs (autonomie). Menger n’arrive pas à saisir la différence entre la « définition juridique du salariat » et les mutations réelles des activités des salariés. Donc que « quelque 86 % des emplois existants sont aujourd’hui des CDI », le dispense de se poser la question sur ce qu’ils font et comment ils les font.
La séparation nette et tranchée entre salarié et entrepreneur perd de l’importance, notamment dans le régime de l’intermittence où, depuis des années, se développe une figure méconnue des statistiques et des analyses sociologiques que dans notre recherche nous avons appelée « Employeur/employé ». Il s’agit une figure hybride que les intermittents mettent en place et gèrent pour s’adapter à la fois aux nouvelles exigences de la production culturelle et pour mener à bien leurs propres projets. Les employeurs/employés échappent aux codifications traditionnelles du marché du travail. Ils ne sont ni des salariés, ni des entrepreneurs, ni des travailleurs indépendants. Ils cumulent leurs différentes fonctions, sans pour autant se réduire à aucunes de ces catégories.
Cette hybridation de statuts pose un grand nombre de problèmes au gouvernement du marché du travail. Le rapport Latarjet sur le spectacle vivant en fait la principale responsable de son mauvais fonctionnement et préconise de retrouver un fonctionnement « normal » des relations professionnelles qui mette fin à cette « exception », en rétablissant la subordination salariale (avec ses droits) et l’autonomie de l’entrepreneur (avec ses devoirs et responsabilités). Cette obsession de revenir à une normalité est tout simplement une fonction disciplinaire qui veut réprimer et méconnaître les nouvelles formes d’activité.
Au contraire, à partir de notre enquête sur les intermittents, nous pouvons souscrire complètement à cette remarque du rapport du Cerc sur la « Sécurité de l’emploi » qui ne fait pas, loin de là, de toutes les hybridations que l’intermittence révèle, une exception, une anormalité: « À la coupure franche entre emploi et chômage, entre travail salarié et travail indépendant s’est substitué une sorte de « halo » de l’emploi, au statut flou – à la fois chômeur et salarié, par exemple, ou indépendant et salarié –, tandis que se multipliaient les types de contrats de travail temporaires (contrats à durée déterminée d’usage, intermittents, intérim) ».
La prétendue « exception » de l’intermittence est en train de devenir la « norme » du régime salarial, comme le prétendent les coordinations des intermittents depuis 1992. Les catégories « ordinaires » ou « classiques » que Menger voudrait rétablir dans le régime de l’intermittence ont du mal à fonctionner même dans les secteurs « normaux » de l’économie. Contrairement à ce qu’il soutient, la différence entre le chômage intermittent et le chômage dans les autres secteurs est une différence de degré et pas de nature.
[1] Cf. pour les citations, ici et par la suite, Luc Boltanski et Eve Chiapello, « Vers un renouveau de la critique sociale », Entretien recueilli par Yann Moulier Boutang, dans Multitudes, N° 3, Paris, 2000 (en ligne sous http://multitudes.samizdat.net/Vers-un-renouveau-de-la-critique.html).
[2] Michel Foucault, Naissance de la biopolitique : Cours au collège de France (1978–1979), Paris: Seuil, 2004, p. 232.
[3] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et Schizophrénie II, Paris: Editions de Minuit, 1980, p. 571.
[4] Pierre-Michel Menger, Les intermittents du spectacle : sociologie d’une exception, Paris: EHESS, 2005.
[5] Pierre-Michel Menger, Profession artiste : Extension du domaine de la création, Paris: Textuel, 2005, p. 53.
[6] Pierre-Michel Menger oppose l’hyperflexibilité de l’intermittence (l’anormalité) à une relative stabilité des autres secteurs de l’économie (la normalité). Ce constat est tout à fait discutable car il est obtenu en confrontant des données concernant l’intermittence, évaluées en termes de flux, et des données qui portent sur le reste de l’économie, mesurées en termes de stocks. Si nous lisons aussi ces derniers en termes de flux, comme le fait une étude de l’Insee (Insee Première, N° 1014, Mai 2005) et le rapport du Cerc sur la « Sécurité de l’emploi » de 2005, nous vérifions aisément que la flexibilité (de l’emploi) est loin d’être une exception spécifique au régime de l’intermittence: « Chaque année le nombre de salariés augmente dans de nombreuses entreprises et diminue dans d’autres, sans que le solde de l’emploi global augmente ou diminue. Ces mouvements bruts de l’emploi des entreprises sont sans commune mesure avec les évolutions nettes de l’emploi total. Ainsi, en sept ans, sur la période 1995 – 2001, on dénombre 17,6 millions de mouvements annuels pour un solde net de 1,6 millions d’emplois. » Chaque année, des millions de personnes perdent leur emploi et des millions d’autres en retrouvent (chaque jour, il y a 33.753 mouvements d’entrée et de sortie). – Le Cerc, dans son rapport sur la « Sécurité de l’emploi », en partant du seul secteur privé, arrive aux mêmes conclusions. « En 2002, l’emploi total (France métropolitaine et Outre-mer) s’élève à environ 25 millions de personnes, l’emploi salarié à 23 millions. De 2001 à 2002, l’emploi s’est accru d’environ 170 000 personnes. Mais cette hausse est le résultat de flux d'embauches et de séparations extraordinairement plus élevés. Ainsi, dans un champ d’environ 13 millions de salariés du secteur privé, les entreprises ont pratiqué, au cours de l’année 2002, 5,2 millions embauches (hors intérim et contrats non renouvelables de durée inférieure à un mois pour remplacement de salariés en congés annuels). Le taux de recrutement avoisine ainsi les 40 %. De même, environ 40 % des salariés ont quitté leur emploi.
[7] Cf. Pierre-Michel Menger, Profession artiste : Extension du domaine de la création, op. cit.
[8] Aucun des objectifs de la « régulation» proposée par Menger n’a été atteints. Depuis 2003 les salaires des intermittents, restés dans le régime, qui constitue le « capital humain » de l’industrie culturelle, ont baissé, pendant que les allocations chômage ont augmenté, notamment pour les catégories qui travaillent directement pour l’industrie culturelle (cinéma et télévision). L’augmentation du revenu (salaire plus indemnités) des intermittents qui ne sont pas sortis du régime et qui constitue le « capital humain » de l’industrie culturelle est payé par la solidarité interprofessionnelle, sans que la CFDT, le Medef et les savants attitrés n’aient rien à redire.
[9] Pierre-Michel Menger, qui se targue d’étudier ce domaine depuis trente ans, confond pourtant systématiquement et allégrement ces deux temporalités. Ce dont il est question au fil de ses analyses et préconisations se borne exclusivement à l’ « emploi » sans que soit jamais envisagé le « travail ».